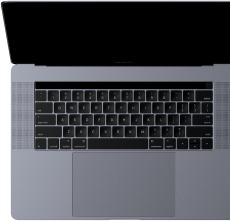Exosquelettes sur les chantiers du BTP : les enseignements d’une expérimentation terrain en Aquitaine, pour mieux les intégrer
Face aux limites trop souvent constatées dans l’usage des exosquelettes sur les chantiers, la commission Santé prévention de la FFB Nouvelle-Aquitaine, en collaboration et avec le soutien de la Carsat Aquitaine et de l’OPPBTP, a mené une expérimentation inédite auprès de quatre entreprises volontaires du BTP, entre 2023 et 2025. Découvrez ses résultats concrets.
Date : 02/10/2025
Virginie Leblanc

© OPPBTP
L’usage des exosquelettes sur les chantiers confronte trop souvent les entreprises à des limites. Face à ce constat, la commission Santé Prévention de la FFB Nouvelle-Aquitaine en collaboration et avec le soutien de la Carsat Aquitaine et de l’OPPBTP, a mené une expérimentation inédite auprès de quatre entreprises volontaires du BTP, entre 2023 et 2025. Inspirée du dispositif TMS Pros déployé par les Carsat, la démarche combine observations terrain, diagnostics ergonomiques et expérimentations en situations réelles pour identifier les conditions d’une intégration raisonnée des dispositifs d’assistance physique (DAP). À la clé : une meilleure compréhension des besoins des compagnons et des enseignements concrets pour adapter les équipements aux réalités des chantiers.
On le sait, de nombreuses entreprises sont aujourd'hui tentées par l'acquisition de DAP et notamment d'exosquelettes, afin de compenser les efforts des opérateurs. Si les premières études expérimentales tendent à démontrer que les exosquelettes peuvent s'avérer efficaces pour limiter certaines contraintes musculaires locales, leur usage en situation réelle de travail soulève néanmoins de nombreuses questions : adaptabilité aux tâches, impact sur la posture, contrainte physiologique sur d’autres parties du corps et acceptabilité par les opérateurs. En résultent des difficultés d’appropriation, de gêne à l’usage ou un abandon rapide des équipements, faute d’adaptation réelle aux gestes métiers ou d’un accompagnement au changement.
Aussi, pour s'assurer que l'exosquelette est adapté à l'opérateur et à la tâche pour laquelle il est envisagé, il est nécessaire de s'appuyer sur une démarche allant de la définition du besoin d'assistance physique jusqu'à son intégration en situation réelle. Dans cette approche, le rôle des ergonomes, des médecins du travail et des préventeurs est déterminant, notamment pour explorer en amont les leviers de prévention collective avant de recourir à un équipement individuel.
C’est précisément dans cette logique d’accompagnement au plus près du terrain que s’inscrivent les travaux conjoints menés par la FFB Nouvelle-Aquitaine et la Carsat Aquitaine, en partenariat avec l’OPPBTP. L'objectif est d'accompagner les artisans et les chefs d'entreprises du bâtiment ainsi que leurs salariés, en vue d'améliorer les conditions de travail et de faire progresser la prévention des risques professionnels en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins.
Un diagnostic terrain pour partir des besoins réels
La première étape de l’expérimentation a consisté en la réalisation, par trois cabinets d’ergonomie indépendants (Ergolibri, LMVT Conseil et NC Ergonomie), d’un diagnostic détaillé des situations de travail de quatre entreprises volontaires. Dans chaque cas, les ergonomes ont observé les gestes réels, les postures, les cadences, les contraintes de site, en s’appuyant sur des chantiers représentatifs.
- C2B, charpentier couvreur basé à Tarnos (Landes), a été observé lors d’activités de montage de structure métalliques en atelier et sur chantier.
- Lamecol, charpentier basé à Canéjan (Gironde) a été étudié sur trois ateliers : l’assemblage et le collage de pièces en bois (lamellé-collé), les finitions et le montage de structures ossatures bois (OSB).
- SCA - Société de charpente Agenaise, basé à Boé (Lot-et-Garonne), a fait l’objet d’observations en atelier et sur chantier plus spécifiquement pour l’activité de pose de tuiles.
- De Laborie, entreprise spécialisée dans la peinture et le revêtement basée à Pau (Pyrénées-Atlantiques), a été analysée sur trois corps de métier : les peintres, les soliers et les poseurs d’isolation thermique par l’extérieur.
Ces observations ont permis de mettre en lumière les situations les plus pénalisantes en termes de port de charges, travail bras en l’air, maintien prolongé en posture contraignante ou gestes répétitifs. Enfin, elles ont montré que certaines contraintes pouvaient être atténuées autrement que par l’usage d’exosquelettes, notamment grâce à des ajustements organisationnels, à l’utilisation ou l’acquisition de matériels adaptés, ou encore par le partage d’expérience entre salariés.
Chaque entreprise a ensuite été accompagnée pour élaborer un cahier des charges précisant ses besoins en assistance physique, puis pour sélectionner et tester différents dispositifs, en conditions réelles, sur ses propres chantiers ou en atelier. Cette phase d’expérimentation a permis d’observer les usages réels, d’identifier les apports, mais aussi les freins, liés à chaque type d’exosquelette testé. A terme, chaque entreprise a pu faire un choix raisonné et éclairé : maintien, ajustement ou abandon de certains dispositifs, mais aussi mise en oeuvre d’actions complémentaires de réorganisation du travail ou de sensibilisation des équipes.
Au-delà de l’usage même des équipements, l’expérimentation a souligné l’importance cruciale de l’accompagnement par des ergonomes, permettant aux entreprises de mieux comprendre les enjeux des TMS, d’analyser finement leurs besoins réels, et d’éviter les achats impulsifs ou mal ciblés.
Cette démarche a également permis d’identifier que certaines situations de travail, notamment les phases de manutention lourde sur des terrains accidentés, restent difficilement compatibles avec les exosquelettes actuels. Ce constat ouvre des pistes d’amélioration pour les fabricants et pose la question de l’adaptation plus large des modes opératoires. Pour permettre à d’autres structures du BTP de s’engager dans une dynamique similaire, deux outils seront diffusés prochainement :
- Un questionnaire pratique d’auto-évaluation, pour aider les entreprises à se poser les bonnes questions en amont d’un projet d’intégration d’exosquelettes.
- Un guide méthodologique, détaillant pas à pas la démarche d’intégration raisonnée des dispositifs d’assistance physique, en cohérence avec la norme NF X 35-800.
Exosquelettes : une expérimentation riche d’enseignements, témoignages
Virginie Larroudé, ingénieure spécialisée en ergonomie, précise : « L’exosquelette n’est pas un simple achat, c’est une démarche guidée par l’ergonomie. En collaboration avec les équipes de Peinture De Laborie, une analyse détaillée de trois situations de travail prioritaires a été menée, mettant en lumière les contraintes physiques rencontrées sur divers chantiers. Cette étude a permis d’établir un cahier des charges précis pour les fournisseurs et d’optimiser le temps alloué par les salariés aux démonstrations et aux essais d’exosquelettes en dehors des postes de travail. Trois modèles ont ainsi été sélectionnés et testés directement sur chantier, spécifiquement pour deux tâches : la peinture de plafonds et la pose de revêtements de sol. »
Nathalie Coulon-Yvars, ergonome (NC Ergonomie), ajoute :
« Un exosquelette ne s’adopte pas, il s’accompagne. Au-delà du choix de l’équipement, c’est l’accompagnement à son intégration qui conditionne réellement la réussite. Trois étapes se sont révélées essentielles : d’abord une présentation des différents exosquelettes pour permettre aux salariés de les découvrir, de les manipuler et de dédramatiser cet outil encore méconnu ; ensuite un test simulé, dans un environnement proche du réel mais sécurisé, par exemple avec la réalisation d’une portion de charpente en atelier ; enfin, si le test s’avère concluant, un essai sur le terrain, au plus près de l’activité réelle. Cette démarche progressive renforce la confiance, réduit les risques de rejet et garantit une mise en oeuvre adaptée et durable. »
Par ailleurs, Marie Tonel, ergonome (cabinet Ergolibri) constate, à travers ses observations de terrain chez Lamécol, que dans certaines phases de l’activité hyper dynamiques requérant un engagement du corps entier, les exosquelettes testés étaient trop contraignants. Sur les postes de collage (laméllé-collé) les rythmes de travail sont très soutenus et cadencés par l'aboutage, les opérateurs se sont sentis gênés dans la fluidité de leurs mouvements, d’autant plus que les contraintes de hauteur sont fortes sur ces postes. Elle ajoute que sur les postes de montage d’ossature bois, c’est plutôt la polyvalence des tâches qui a conduit à abandonner les essais d'exosquelettes car aucun modèle ne correspondait au besoin. En effet, ces constats permettent d’entrevoir de nouvelles pistes d’amélioration pour les fabricants, en termes de design et de matériaux pour améliorer le confort des exosquelettes. Ils mettent également en lumière l’importance de l’analyse de l’activité en ergonomie pour appréhender plus globalement les caractéristiques physiques, les caractéristiques de l’environnement de travail et celles de l’organisation.
Cependant pour des tâches très spécifiques et pénalisantes (gestes répétitifs, bras devant soi en station debout prolongée), les évaluations in situ se sont révélées positives, et l’entreprise est sur le point de concrétiser l’achat de l’exosquelette. « Mon accompagnement a permis à Lamécol de cibler l’exosquelette adapté aux modes opératoires spécifiques aux tâches de ponçage et de lasurage. En réalisant le cahier des charges, j’ai pu identifier les zones du corps à soulager. Pour cela, les observations et les échanges avec les deux opérateurs concernés ont été essentiels. Au final, sur six modèles d’exosquelettes testés dans trois ateliers, un seul a été retenu pour deux opérateurs du panel, ce qui fait relativiser la notion de “déploiement” à grande échelle des DAP », remarque l’ergonome.
Enfin, la spécificité de l’expérimentation chez Lamécol, c’est la place centrale donnée au binôme médecin du travail - ergonome. « Dans le cadre de l’expérimentation, le médecin du travail a été associé très tôt au projet, avant même de procéder aux tests d’exosquelettes. Il était capital de s’assurer que les personnes volontaires, impliquées dans cette démarche étaient en “bonne santé” et sans restriction d’aptitude. Nous avons fait ce choix avec le médecin du travail pour neutraliser le risque de biais méthodologique dans l’évaluation du dispositif. Aussi, parce que nous avons considéré que nous étions dans une logique de prévention primaire et non de maintien en emploi qui relève d’un autre type d’accompagnement. »
Découvrez le magazine PréventionBTP
Découvrez notre magazine : conseils d'experts, innovations et meilleures pratiques pour garantir la sécurité sur vos chantiers.
Dernières infos :
Le magazine :
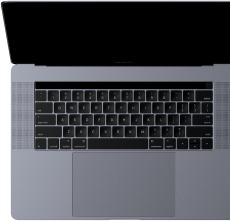
Découvrez la newsletter PréventionBTP
Tous les indispensables pour gérer et se former sur la prévention : les dernières actualités en prévention et dans le BTP et bien plus encore... C’est par ici !