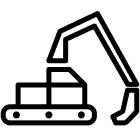Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Tous les articles de votre recherche
Résultats de la recherche
5652 Résultats
Résultats par page :10
Droit de la prévention
12 janvier 2026Article D6214-4 du Code des transports
Depuis la refonte de la réglementation européenne relative aux drones en 2019, il n'y a plus de distinction entre les vols de loisir et professionnel. Deux catégories d'opérations ont été créées : la catégorie ouverte et la catégorie spécifique.Le certificat d'aptitude théorique de télépilote (CATT) que mentionne l'article D6214-4 est désormais uniquement exigé pour les télépilotes qui opèrent en catégorie spécifique dans le cadre des scénarios standard de vol.Les télépilotes qui opèrent en catégorie spécifique doivent ainsi détenir :1) pour la partie théorique, le CATT délivré après la réussite à un examen organisé par la DGAC.2) ainsi que, pour la partie pratique, une attestation de suivi de formation délivrée par un organisme de formation qui assure la formation pratique basique pour le ou les scénarios considérés.Les objectifs et modalités de formation des télépilotes sont précisés par un arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir.Le tableau ci-dessous récapitule les compétences requises des télépilotes selon le type de vol opéré :
Drones - Résumé des exigences de formation des télépilotes professionnels
Droit de la prévention
12 janvier 2026Article D6214-8 du Code des transports
Conformément à l'article D6214-8 du Code des transports, un arrêté du 18 mai 2018 définit les exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir.
Droit de la prévention
12 janvier 2026Article D6214-9 du Code des transports
L'arrêté visé par l'article D6214-9 du Code des transport est l'arrêté du 18 mai 2018 relatif aux exigences applicables aux télépilotes qui utilisent des aéronefs civils circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir (articles 10 et suivants).
Droit de la prévention
9 janvier 2026Article 1er de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord
L'arrêté du 3 décembre 2020 fixe les modalités d'utilisation de l'espace aérien par les exploitants de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord (dits aussi drones).Pour mémoire, il existe trois catégories d'exploitation de drones :- Les exploitations ouvertes (dites vols en catégorie ouverte) : elles ne nécessitent aucune autorisation ou déclaration de l’exploitant avant le vol. Elles regroupent les opérations de vol simples et à faible risque (vol en vue directe dans des zones géographiques qui représentent un faible risque pour la circulation aérienne et pour les personnes).- Les exploitations spécifiques (dites vols en catégorie spécifique) : elles concernent soit des vols opérés selon des scénarios standard de vol soit opérés selon une autorisation d’exploitation délivrée par la DGAC en France. Elles regroupent les opérations à risque modéré (vol à vue ou hors vue dans des conditions différentes de la catégorie ouverte). - Les exploitations certifiées (dites vols en catégorie certifiée) : Elles nécessitent que le drone et son exploitant soit certifié et, le cas échéant, la délivrance d'une licence au pilote. Elles regroupent les opérations à haut risque nécessitant un niveau élevé de fiabilité du drone et des opérations (par exemple : le transport de personnes ou de marchandises dangereuses). La catégorie certifiée n'étant pas représentative des utilisations de drones dans les domaines du BTP, elle n'est pas abordée dans le Droit de la prévention.L'arrêté du 3 décembre 2020 aborde notamment les points suivants :- les disposition générales d'utilisation des drones dans les catégories ouverte et spécifique ;- les restrictions et interdictions de survol.
Droit de la prévention
9 janvier 2026Article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord
L'article 2 précise les définitions des termes employés par le texte et notamment les définitions de télépilote et de zone peuplée.Pour mémoire, l'arrêté du 3 décembre 2020 fixe les modalités d'utilisation de l'espace aérien par les exploitants de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord (dits drones). Il aborde notamment les points suivants :- les disposition générales d'utilisation des drones dans les catégories ouverte et spécifique ;- les restrictions et interdictions de survol.