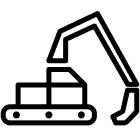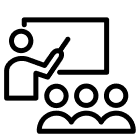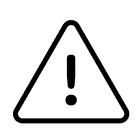Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Tous les articles de votre recherche
Résultats de la recherche
5652 Résultats
Résultats par page :10
Droit de la prévention
9 janvier 2026Article 3 de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'utilisation de l'espace aérien par les aéronefs sans équipage à bord
L'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 2020 précise les conditions de vol suivantes :1) En principe, un drone doit être utilisé le jour, ce qui correspond aux principaux usages dans les domaines du BTP. L'utilisation d'un drone la nuit est strictement encadrée par les conditions posées à cet article. 2) Le télépilote doit rester éloigné d'un autre aéronef et doit prévenir tout risque de collision. Pour cela, il doit :- détecter visuellement et auditivement tout aéronef qui se rapprocherait de son drone (il peut se faire assister par un tiers pour répondre à ces modalités de détection) ; - céder le passage à tout aéronef habité et appliquer vis-à-vis des autres aéronefs sans équipage à bord les dispositions de prévention des abordages prévues par les règles de l’air (Voir article 4 du Règlement (UE) 2019/947. Exemples de règles : priorité à droite, priorité à l’aéronef le plus bas, priorité à l'aéronef le moins manœuvrant). - lors d'un vol hors vue en catégorie spécifique, veiller à ce que le drone reste hors des nuages de façon à rester visible des autres aéronefs.L'arrêté du 3 décembre 2020 fixe les modalités d'utilisation de l'espace aérien par les exploitants de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord (dits drones). Il encadre notamment les conditions d'utilisation des drones dans les catégories ouverte et spécifique. D'une manière générale, la réglementation applicable aux drones a pour objectif de protéger les personnes au sol d'un accident avec un drone, mais également de protéger les autre usagers de l'espace aérien d'une éventuelle collision.
Droit de la prévention
6 janvier 2026Article R4451-63 du Code du travail
Cet article renvoie notamment vers l'arrêté du 21 décembre 2007 définissant les modalités de formation et de délivrance du certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle (CAMARI). ce dernier détermine notamment :- les appareils de radiologie industrielle qui ne peuvent être manipulés que par un salarié titulaire d'un certificat d'aptitude compte tenu de la nature de l'activité exercée, des caractéristiques et des modalités de mise en oeuvre de l'appareil ;- le contenu et la durée de la formation des salariés qui manipulent ces appareils que doit organiser l'employeur ;- la qualification que doivent avoir les personnes chargées de la formation ;- les modalités de contrôle des connaissances et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude (CAMARI) ;- la durée de validité du certificat et les conditions de son renouvellement.A noter l'entrée en vigueur de cet article a été différée au 1er juillet 2027 (voir en ce sens l'article 2 du décret n° 2025-1347).
Droit de la prévention
5 janvier 2026Article R4451-38 du Code du travail
Dans une installation nucléaire, une zone contrôlée est une zone dont l'accès et où le séjour sont soumis à des restrictions pour des raisons de protection contre les rayonnements ionisants ou de confinement de la contamination radioactive.Une zone contrôlée jaune présente un risque d'irradiation. Une zone contrôlée orange présente un danger de contamination. Une zone contrôlée rouge présente un danger d'irradiation et de contamination.Si une entreprise extérieure intervient pour la réalisation de travaux dans l'une de ces zones, les travailleurs doivent impérativement être titulaires d'une certification justifiant de leur capacité à accomplir certaines activités ou opérations sous rayonnements ionisants. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Cofrac.Les modalités de cette certification sont précisées par un arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités.A noter, l'entrée en vigueur est différée au 1er juillet 2027.Les entreprises qui sont titulaires du certificat peuvent poursuivre les interventions que ce certificat permet après le 1er juillet 2027 et jusqu'à la fin de sa validité, si l'organisme certificateur a procédé avant cette date, lors de l'audit de surveillance ou de renouvellement prévu dans le cadre de leur certification, aux vérifications permettant de s'assurer que ces entreprises respectent les exigences résultant des dispositions des articles R4451-38 et R4451-39 du code du travail.
Droit de la prévention
5 janvier 2026Article R4451-39 du Code du travail
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture doit venir déterminer :1° Les activités ou catégories d'activité pour lesquelles une certification est requise en raison de la nature et de l'importance du risque ;2° Les modalités et conditions de certification des entreprises exerçant les activités susmentionnées ;3° Les modalités et conditions de présence du conseiller en radioprotection ou, le cas échéant, du salarié compétent en radioprotection, lors des travaux dans les zones contrôlées jaune, orange ou rouge, ainsi que dans les zones d'opération délimitées dans un établissement comprenant une installation nucléaire de base ;4° Les modalités de suivi des salariés intérimaires et de relations de ces derniers avec leur entreprise de travail temporaire ;5° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification.A noter, l'entrée en vigueur de cet article a été différée au 1er juillet 2027
Droit de la prévention
5 janvier 2026Article R4451-53 du Code du travail
Cet article fixe la nature des informations à conserver, pendant au moins 10 ans.Depuis le 1er janvier 2025, cette évaluation individuelle préalable doit notamment contenir le type de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants du travailleur à mettre en œuvre.Nota : Cette évaluation est conduite par l'employeur avec l'appui du conseiller en radioprotection qu'il a désigné en application des dispositions de l'article R4451-112 du code du travail. Elle permet notamment à l'employeur de déterminer le "classement" du travailleur qu'il propose au médecin du travail au regard du niveau de dose que le travailleur est susceptible de recevoir sur douze mois consécutifs. L'évaluation est réalisée en cohérence avec l'évaluation des risques professionnels, au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste. S'agissant d'une étape de l'évaluation des risques professionnels, celle-ci doit être renouvelée en tant que de besoin.