Votre recherche Droit de la prévention
Quel que soit votre domaine d'expertise, retrouvez l'ensemble de la réglementation du BTP en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Ces règles sont décryptées par nos spécialistes qui vous proposent également des supports et outils facilitant leur mise en œuvre : jurisprudences, guides, questions/réponses, affiches...
Tous les articles droit de la prévention
Résultats de la recherche
161 Résultats
Résultats par page :5
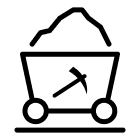
Droit de la prévention
16 avril 2024Article 1er de l'arrêté du 11 juin 2019 fixant la liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
Cet arrêté fixe la liste des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels un plan de prévention doit être impérativement établi par écrit.Il intègre notamment les travaux souterrains exposant les personnes à des chutes de hauteur de plus de 3 mètres.Cette liste s'ajoute à celle des travaux dangereux fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 pris en application de l'article R4512-7 du Code du travail.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article 1er de l'arrêté du 19 mars 1993 fixant, en application de l'article R. 4512-7 du code du travail, la liste des travaux dangereux pour lesquels il est établi par écrit un plan de prévention
Le plan de prévention doit obligatoirement faire l'objet d'un document écrit notamment lorsque tout ou partie des travaux à effectuer pour réaliser l'opération sont des travaux dangereux. L'arrêté du 19 mars 1993 fixe ainsi la liste des 21 travaux considérés comme dangereux et imposant l'établissement d'un plan de prévention par écrit.A noter :4. Le plan d'opération interne est un plan de gestion de crise en cas d'incidents et de sinistres, imposé par l'article L515-41 du Code de l'environnement à certaines ICPE (installations classées pour la protection de l'environnement) présentant des dangers particulièrement importants pour la sécurité et la santé des populations voisines et de l'environnement (il s'agit notamment des installations dites Seveso).5. Les travaux de maintenance sur les équipements de travail devant faire l'objet de vérifications générales périodiques (autres que les appareils et accessoires de levage) concernent notamment les échafaudages, les ascenseurs, les montes-charges, les véhicules à benne basculante ou à cabine basculante, les machines à cylindre, ou encore les équipements de travail pouvant être séparés de leur sources d'alimentation ou présentant un risque de dissipation des énergies cumulées à l'intérieur de ces équipements.11. les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de travail auxquels est applicable l'article R4324-17 du Code du travail visent les équipemens de travail que seuls peuvent utiliser les travailleurs désignés à cet effet. L'utilisation, la maintenance et la modification de ces équipement sont effectuées uniquement par les travailleurs spécifiquement affectés à ce type de tâche.
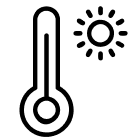
Droit de la prévention
2 juin 2025Article R4463-8 du Code du travail
La prévention des risques liés aux épisodes de chaleur intense doit être pris en compte dans les plans de prévention, les PPSPS et le PGC SPS.Pour mémoire, l'épisode de chaleur intense est l'atteinte du seuil de niveau de vigilance « jaune » ou « orange » ou « rouge » :- « vigilance jaune » correspondant à un pic de chaleur : exposition de courte durée (1 ou 2 jours) à une chaleur intense présentant un risque pour la santé humaine, pour les populations fragiles ou surexposées, notamment du fait de leurs conditions de travail ou de leur activité physique. Il peut aussi correspondre à un épisode persistant de chaleur : températures élevées durablement (indices bio-météorologiques (IBM) proches ou en dessous des seuils départementaux) ;- « vigilance orange » correspondant à une période de canicule : période de chaleur intense et durable pour laquelle les indices bio-météorologiques atteignent ou dépassent les seuils départementaux, et qui est susceptible de constituer un risque sanitaire pour l'ensemble de la population exposée, en prenant également en compte d'éventuels facteurs aggravants (humidité, pollution, précocité de la chaleur, etc.) ;- « vigilance rouge » correspondant à une période de canicule extrême : canicule exceptionnelle par sa durée, son intensité, son extension géographique qui présente un fort impact sanitaire pour l'ensemble de la population ou qui pourrait entraîner l'apparition d'effets collatéraux, notamment en termes de continuité d'activité.
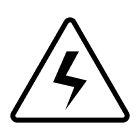
Droit de la prévention
14 janvier 2025Article 32 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Lors de l'exécution de travaux d'abattage des arbres et travaux connexes d'ébranchage, façonnage, billonnage, débusquage ou débardage, les points de passage des équipements de travail mobiles ou de véhicules routiers sous les lignes aériennes sont portés sur le plan de prévention pour les chantiers qui y sont soumis.
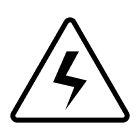
Droit de la prévention
23 décembre 2024Article R4544-20 du Code du travail
Pour les travaux d'ordre non électrique dans l'environnement d'ouvrages électriques non soumis à l'obligation de déclaration ou de convention portant sur la sécurité des travaux, l'employeur doit demander à l’exploitant de l’ouvrage les informations et indications sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques, ainsi que sur les précautions à prendre pour effectuer les travaux en sécurité. Celui-ci les lui communique, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, dans un délai utile pour la réalisation des travaux et tient compte de leur éventuel caractère urgent.Pour les travaux réalisés dans l'environnement d'une installation électrique lors d’opérations de bâtiment et de génie civil soumises à coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs (CSPS), les informations et indications sur la localisation des ouvrages ou installations électriques concernés, sur leurs caractéristiques, ainsi que sur les précautions à prendre pour effectuer les travaux en sécurité doivent figurer au sein du plan général de coordination SPS et figurent parmi les données recueillies lors de l’inspection commune.Dans les autres cas, ces informations et indications sont recueillies lors de l’inspection commune des lieux de travail, de l’analyse commune des risques, et du plan de prévention réalisés préalablement à l’exécution d’une opération réalisée par l’entreprise extérieure.
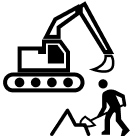
Droit de la prévention
20 septembre 2024Article 11 de l'arrêté du 29 mai 2024 relatif aux interventions hyperbares sans immersion effectuées dans le domaine de la santé (mention C)
Les procédures d’intervention et de secours sont établies par l’employeur avant toute intervention hyperbare.Ces procédures figurent dans le manuel de sécurité hyperbare et dans les PPSPS ou les plans de prévention pour les opérations qui y sont soumises.
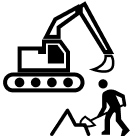
Droit de la prévention
4 juillet 2024Article 11 de l'arrêté du 22 avril 2024 relatif aux travaux hyperbares effectués sans immersion (mention D)
L’employeur doit établir les procédures de travail et de secours préalablement à l'exécution de l'opération, et les consigner dans le manuel de sécurité hyperbare et, le cas échéant, dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ou dans le plan de prévention. L'article 11 définit également les éléments à prendre en compte dans les différents scenarii potentiels des procédures de secours.Cet article précise le rôle du surveillant lors de la mise en œuvre des procédures de secours : il est tenu de déclencher et de mettre en oeuvre les procédures de secours, et d'en informer immédiatement l'employeur et le conseiller à la prévention hyperbare.

Droit de la prévention
24 mai 2024Article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
L'arrêté du 27 novembre 2013 impose des exigences spécifiques aux entreprises extérieures qui interviennent dans un établissement exerçant des activités nucléaires.En situation de coactivité, afin de s'assurer de la protection effective des travailleurs contre les risques radiologiques, le présent arrêté fixe les exigences spécifiques relatives à l'organisation du travail et de la radioprotection des travailleurs. Cet arrêté définit également la procédure de certification requise pour les entreprises concernées.Cet article fixe les objectifs de la certification des entreprises en précisant qu’il a pour objet d'attester la capacité de l'entreprise concernée à mettre en œuvre et tenir à jour un système de management garantissant la protection des travailleurs lorsqu'ils effectuent des opérations sous rayonnements ionisants. Ce certificat vise, en matière de radioprotection, à s'assurer de la capacité de l'entreprise à élaborer et à mettre en œuvre des démarches d'évaluation des risques, à déployer les compétences nécessaires lors des opérations pour garantir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs, à organiser les opérations, à optimiser les expositions et à analyser et prendre en compte les retours d'expérience.A cet effet, le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification démontre sa capacité à mettre en œuvre, au regard de la nature et de l'importance du risque, les mesures prévues par le plan de prévention mentionnées à l'article R4512-8 du Code du travail et, selon le cas, celles prévues par le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionnées à l'article R4532-64 du Code du travail.Les exigences spécifiques applicables aux entreprises extérieures ou aux entreprises de travail temporaire sont précisées en annexes 1 et 2 de l'arrêté du 27 novembre 2013.

Droit de la prévention
26 avril 2024Article R4451-35 du Code du travail
Cet article complète les dispositions réglementaires en matière de coordination prévues à l'article R4511-5 du Code du travail et suivants et impose notamment l'implication du conseiller en radioprotection ou du salarié compétent mentionné au I de l'article L4644-1 du Code du travail dans la mise en œuvre des mesures de prévention prévues au présent chapitre. Cette exigence s'explique au regard de la complexité technique de mise en œuvre de plusieurs de ces mesures de prévention.Le champ d'application de ce chapitre étant étendu aux travailleurs indépendants, cet article étend les mesures de coordination à ce statut. il vise également les transporteurs lorsque ceux-ci sont concernés.Compte tenu de la spécificité de certains équipements de protection individuelle ou appareils de mesure, notamment dans les installations nucléaires, cet article ouvre la possibilité à des accords encadrant les conditions de mise à disposition de ces derniers.
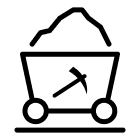
Droit de la prévention
16 avril 2024Article 5 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
Lorsqu'un salarié d'une entreprise extérieure est amené à réaliser des travaux dangereux dans des mines, carrières ou dans leurs dépendances, un plan de prévention avec l'entreprise utilisatrice doit être établi par écrit (quelle que soit la durée prévisible de l'opération).Le plan de prévention doit notamment être tenu à la disposition de l'inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'OPPBTP.A noter, cette obligation n'est pas nouvelle, elle était déjà imposée par le RGIE dans son titre relatif aux entreprises extérieures.Un arrêté du 11 juin 2019 fixe une liste des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels un permis de travail et un plan de prévention écrit doivent être établis. Il intègre notamment les travaux souterrains exposant les personnes à des chutes de hauteur de plus de 3 mètres.Cette liste s'ajoute à celle des travaux dangereux fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 pris en application de l'article R4512-7 du Code du travail.
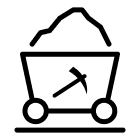
Droit de la prévention
16 avril 2024Article 6 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
Le plan de prévention doit être tenu à disposition des organismes extérieurs de prévention qui interviennent dans les carrières (ex : CPIA, Prevencem, AGEOX) ainsi que de l'inspection du travail, des agents de prévention des CARSAT et de l'OPPBTP.
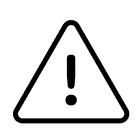
Droit de la prévention
27 mars 2024Article R4462-5 du Code du travail
Lorsque c'est une entreprise, dite extérieure, qui réalise une activité pyrotechnique sur le site d'une autre entreprise, dite entreprise utilisatrice, il apaprtient à l'entreprise extérieure de délivrer à l'entreprise utilisatrice son étude de sécurité, qui est annexée au plan de prévention.Lorsque les travailleurs de l'entreprise utilisatrice participent également à l'activité pyrotechnique, c'est alors à l'entreprise utilisatrice de réalise l'étude de sécurité pyrotechnique qui devra ensuite être validée par l'entreprise extérieure.Les comités sociaux et économiques (CSE) des entreprises utilisatrices et extérieures sont consultés.Lorsqu'une entreprise extérieure réalise une activité non pyrotechnique dans une installation pyrotechnique d'une entreprise utilisatrice, les conclusions de l'étude de sécurité pyrotechnique réalisée par l'entreprise utilisatrice sont indiquées dans le plan de prévention.Lorsqu'une entreprise extérieure procède au chargement ou au déchargement de substances ou objets explosifs sur le site d'une entreprise utilisatrice, les conclusions de l'étude de sécurité et réalisée par l'entreprise extérieure et du document relatif au transport de sustances ou objets explosifs à destination ou en provance de la voie publique, doivent être reportées dans le protocole de sécurité, dit protocole de chargement et de déchargement.Pour toute activité pyrotechnique réalisée sur une opération soumise à coordination sécurité protection de la santé (SPS), les conclusions de l'étude de sécurité pyrotechnique doivent figurer dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) de l'entreprise réalisant l'activité pyrotechnique.
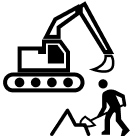
Droit de la prévention
18 avril 2023Article 12 de l'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares effectués en milieu subaquatique (mention A)
L'arrêté du 14 mai 2019 relatif aux travaux hyperbares relevant de la mention A précise les procédures de travail.Les procédures de travail et de secours doivent être établies avant tout chantier et consignées dans le Manuel de sécurité hyperbare (MSH) de l'entreprise.Cependant, elles doivent être adaptées au contexte de plongée rencontré.Le Chef d'opération hyperbare (COH) devra informer l'ensemble des travailleurs hyperbares du contenu de ces procédures et des modalités d'application sur site.Il est important que cette procédure tienne compte des contraintes liées à la co-activité sur le site de travaux. La procédure sera donc consignée dans le PPSPS ou le plan de prévention en cas d'intervention en coactivité.C'est au surveillant qu'il appartient de déclencher la procédure de secours et de la mettre en oeuvre. Il doit en informer son employeur et le Conseiller à la prévention hyperbare (CPH).
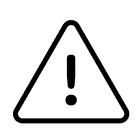
Droit de la prévention
31 mars 2023Annexe 5 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Cette annexe précise les compétences devant être acquises, pour obtenir l'AIPR par les personnes suivantes :- les personnes assurant l'encadrement des opérations sous la direction du responsable du projet (Annexe 5-1) ;- les personnes assurant l'encadrement des travaux sous la direction de l'exécutant des travaux (Annexe 5-2) ;- les conducteurs d'engins et les suiveurs intervenant sous la direction de l'exécutant des travaux (Annexe 5-3).

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4512-6 du Code du travail
L'inspection commune préalable permet aux chefs d'entreprises utilisatrice et extérieures d'échanger des informations et de recueillir des éléments leur permettant d'analyser en commun les risques pouvant résulter de la co-activité durant l'opération. Cette analyse des risques est effectuée sous la responsabilité de chacune des entreprises pour ce qui la concerne.Dès lors qu'ils estiment que des risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et les matériels existent, ils doivent établir d'un commun accord, et avant le début des travaux, un plan de prévention visant à définir les mesures prises par chaque entreprise pour prévenir ces risques.La circulaire DRT n°93-14 du 18 mars 1993 met l'accent sur le caractère essentiel de l'analyse des risques : la qualité du plan de prévention dépend directement du soin apporté à l'évaluation de la nature et de la gravité des risques susceptibles de découler de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels.A noter : pour les opérations répétitives régies par un contrat annuel, il est possible de rédiger un plan de prévention annuel qui sera actualisé si les conditions de réalisation de l'opération évoluent ou en cas d'apparition de nouveaux risques à travers un document de type permis de travail par exemple. Ce permis de travail devient alors une annexe ou un avenant au plan de prévention annuel.A contrario, si les chefs d'entreprises estiment, sous leur responsabilité, que ces risques n'existent pas et que les travaux effectués n'entrent pas dans les cas ou le plan de prévention écrit est obligatoire, alors aucun plan de prévention n'est à établir. Dans ce cas, il appartient notamment à l'entreprise utilisatrice de justifier cette décision ainsi que l'absence de risque lié à la co-activité à travers les résultats de l'analyse des risques.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4512-7 du Code du travail
Le plan de prévention est obligatoire dès lors que les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures ont identifié des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, les installations et les matériels durant l'exécution de l'opération.Le Code du travail prévoit que ce plan de prévention doit obligatoirement être écrit dans deux cas :- Lorsque l'opération représente une durée de travail dépassant 400 heures sur une période inférieure ou égale à 12 mois (que les travaux soient continus ou discontinus). Il convient d'additionner le nombre d'heures de travail prévisibles à effectuer par tous les salariés des entreprises participant à l'opération (y compris les entreprises sous-traitantes) pour la détermination du seuil ;- Lorsque tout ou partie des travaux à effectuer pour réaliser l'opération figurent sur la liste des travaux dangereux définie par un arrêté du 19 mars 1993.En dehors de ces deux cas, le plan de prévention peut être oral ou écrit. Toutefois, compte tenu de la nature des éléments devant figurer dans le plan de prévention, il est vivement conseillé de formaliser systématiquement par écrit le plan de prévention (par le biais d'un plan de prévention simplifié par exemple), cela assure également une meilleure traçabilité des mesures de prévention mises en œuvre pour l'opération. Un plan de prévention écrit permet également à l'entreprise utilisatrice de justifier qu'elle a bien informé l'entreprise extérieure des risques liés à son activité.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4512-8 du Code du travail
L'article R4512-8 du Code du travail définit précisément le contenu minimum du plan de prévention. Ainsi, les mesures suivantes doivent nécessairement figurer dans le plan de prévention :1° La définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;2° L'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien. Le raccordement aux réseaux existants sur le site des matériels, engins et équipements de travail introduits par les entreprises extérieures est notamment concerné par cette mesure.3° Les instructions à donner aux travailleurs ;4° L'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l'entreprise utilisatrice ;5° Les conditions de la participation des travailleurs d'une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d'assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l'organisation du commandement. Cette mesure vise surtout à répertorier et décrire les conditions et modalités de la sous-traitance effectuées par les entreprises extérieures, en précisant l'organisation du commandement des salariés de l'entreprise extérieure et de ses sous-traitantsEn plus de ces mesures obligatoires, le plan de prévention devra être élargi et complété pour tenir compte des risques propres à chaque opération.A noter : En pratique, il est possible de rédiger un plan de prévention annuel surtout pour les opérations répétitives régies par un contrat annuel par exemple. Le plan de prévention annuel ne devra pas être trop général et devra être actualisé et adapté si les conditions de réalisation de l'opération évoluent, ou encore en cas d'apparition de nouveaux risques.L'OPPBTP vous propose un modèle type de plan de prévention qu’il convient d’adapter à la nature de l'intervention pour laquelle il est réalisé.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4512-9 du Code du travail
Le plan de prévention doit contenir la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever du suivi individuel renforcé en fonction des risques liés aux travaux qu'ils réalisent dans l'entreprise utilisatrice. Il appartient à chaque entreprise extérieure qui intervient au sein de l'entreprise utilisatrice de fournir cette liste.Le suivi individuel renforcé est encadré par les articles R.4624-22 à R4624-28 du Code du travail. Il concerne les salariés exposés à des risques particuliers (amiante, plomb, CMR, milieu hyperbare, chute de hauteur lors des opérations de montage et démontage d'échafaudage, etc.) ainsi que les salariés affectés à un poste soumis à un examen d'aptitude spécifique (conduite de certains équipements de travail, habilitations électriques, jeunes de moins de 18 ans affectés à des travaux réglementés, etc.). Pour d'autres situations, l'employeur peut également estimer, au regard de l'évaluation des risques, qu'un salarié doit bénéficier d'un suivi individuel renforcé.L'OPPBTP vous propose un modèle type de plan de prévention qu’il convient d’adapter à la nature de l'intervention pour laquelle il est réalisé.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4512-10 du Code du travail
Les salariés des entreprises extérieures bénéficient des dispositions règlementaires en matière d'installations sanitaires, de vestiaires et de locaux de restauration. L'entreprise utilisatrice est tenue de leur mettre à disposition ses locaux et installations. Le plan de prévention précise alors la répartition des charges d'entretien entre les différentes entreprises extérieures dont les salariés utilisent les locaux et installations mis à disposition par l'entreprise utilisatrice. Les entreprises extérieures ont également la possibilité de mettre en place un dispositif équivalent afin que leurs salariés bénéficient d'installations sanitaires, de vestiaires et de locaux de restauration pendant toute la durée de l'intervention.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4512-11 du Code du travail
Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux contenant de l'amiante (le dossier technique amiante ou encore le dossier amiante-parties privatives) ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante, doivent être joints au plan de prévention.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4512-12 du Code du travail
Les plans de prévention écrits sont tenus à la disposition de l'inspection du travail, de la Carsat/Cramif, et de l'OPPBTP durant toute la durée des travaux. Ils doivent également être tenus à la disposition du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures intéressées (article R4513-9 du Code du travail), et du CSE de chaque entreprise (article R4514-2 du Code du travail).Le chef de l'entreprise utilisatrice est par ailleurs tenu d'informer par écrit l'inspection du travail de l'ouverture des travaux.Pour rappel, le plan de prévention est obligatoirement réalisé par écrit- Lorsque l'opération représente une durée de travail dépassant 400 heures sur une période inférieure ou égale à 12 mois (que les travaux soient continus ou discontinus).- Lorsque tout ou partie des travaux à effectuer pour réaliser l'opération figurent sur la liste des travaux dangereux définie par un arrêté du 19 mars 1993.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4513-1 du Code du travail
Les articles R4513-1 et suivants du Code du travail encadrent les mesures de coordination à mettre en oeuvre par l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure pendant l'exécution des travaux. Tout comme la coordination préalable à l'opération, le Code du travail prévoit que la coordination des mesures de prévention pendant l'exécution des travaux est à l'initiative de l'entreprise utilisatrice : elle doit s'assurer que les chefs des entreprises extérieures respectent bien les mesures décidées dans le plan de prévention. Elle coordonne également la mise à jour de ces mesures en fonction des évolutions et de la situation réelle de travail.De son côté, l'entreprise extérieure est tenue de mettre en oeuvre les mesures prévues dans le plan de prévention.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4513-4 du Code du travail
Les nouvelles mesures décidées lors des réunions et inspections périodiques de coordination doivent figurer dans le plan de prévention, lequel est alors mis à jour.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4513-9 du Code du travail
Le plan de prévention écrit doit être tenu à la disposition du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures intéressées (en plus de l'inspection du travail, de la Carsat/Cramif et de l'OPPBTP). Les médecins du travail sont également informés des mises à jour du plan de prévention.En dehors de ces deux cas, les médecins du travail peuvent demander que le plan de prévention, et ses mises à jour, leur soient communiqués.Pour rappel, le plan de prévention est obligatoirement réalisé par écrit - Lorsque l'opération représente une durée de travail dépassant 400 heures sur une période inférieure ou égale à 12 mois (que les travaux soient continus ou discontinus). - Lorsque tout ou partie des travaux à effectuer pour réaliser l'opération figurent sur la liste des travaux dangereux définie par un arrêté du 19 mars 1993 (ajouter lien hypertexte de la page sur l'arrêté https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000179892/ ).

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4514-2 du Code du travail
Le plan de prévention écrit doit être tenu à la disposition :- de l'inspection du travail, de la Carsat/Cramif et de l'OPPBTP ;- du médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures intéressées ;- des CSE de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures.D'une manière générale les CSE doivent être informés de toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.Pour rappel, le plan de prévention est obligatoirement réalisé par écrit- Lorsque l'opération représente une durée de travail dépassant 400 heures sur une période inférieure ou égale à 12 mois (que les travaux soient continus ou discontinus).- Lorsque tout ou partie des travaux à effectuer pour réaliser l'opération figurent sur la liste des travaux dangereux définie par un arrêté du 19 mars 1993.Pour rappel, le CSE de chaque entreprise peut demander la communication du plan de prévention et ses mises à jour.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4514-3 du Code du travail
Le CSE de l’entreprise utilisatrice dispose d’une compétence générale en ce qui concerne la coordination des mesures de prévention : un ou plusieurs de ses membres peuvent participer à l'inspection commune préalable.Parallèlement, le CSE des entreprises extérieures disposent d’une compétence plus restreinte : ils ont la possibilité de participer uniquement à l'inspection commune liée à l’opération à laquelle leur entreprise participe. Cette participation est encadrée par l'article R4514-9 du Code du travail.Les membres des CSE (entreprise utilisatrice et entreprise extérieure) qui participent à l'inspection commune préalable doivent émettre un avis sur les mesures de prévention envisagées, cet avis sera porté sur le plan de prévention lorsque celui-ci est formalisé par écrit.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4514-6 du Code du travail
Le CSE de l’entreprise utilisatrice dispose d’une compétence générale en ce qui concerne la coordination des mesures de prévention : pendant la réalisation des travaux, un ou plusieurs de ses membres peuvent être désignés pour participer aux inspections et réunions périodiques de coordination.Ils émettent alors un avis sur les mesures de prévention définies lors de ces réunions et inspections, cet avis devra être mentionné sur le plan de prévention lorsque ce dernier est formalisé par écrit.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4514-8 du Code du travail
Durant l'exécution des travaux, lorsqu'une entreprise extérieure participe aux réunions et inspections périodiques de coordination organisée par l'entreprise utilisatrice, son CSE a la possibilité de désigner un de ses membres pour y assister. Le membre du CSE de l'entreprise extérieure émet un avis sur les mesures de prévention définies lors de ces réunions et inspections et qui sera porté dans le plan de prévention écrit.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4515-1 du Code du travail
Les dispositions du Code du travail relatives à la réalisation de travaux dans un établissement par une entreprise extérieure sont par principe applicables aux opérations de chargement et de déchargement réalisées par des entreprises extérieures transportant des marchandises, en provenance ou à destination d'un lieu extérieur à l'enceinte de l'entreprise utilisatrice, dite « entreprise d'accueil ».Cependant, en raison des spécificités des opérations de chargement et de déchargement, certaines de ces dispositions ne leur sont pas applicables. Elles dérogent en effet aux obligations suivantes :- à la transmission à l'inspection du travail de l'état des heures passées à l'exécution de l'opération, prévue à l'article R. 4511-12 (lien hypertexte) ;- à l'inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 à R. 4512-5 (lien hypertexte) ;- au plan de prévention prévu aux articles R. 4512-6 à R. 4512-11 (lien hypertexte) ;- à l'information et à la communication au CSE des renseignements et documents prévues aux articles R. 4514-1 et R. 4514-2 (lien hypertexte), c'est à dire la communication du plan de prévention et l'information des mises à jour du plan de prévention et des dates des inspections et réunions périodiques de coordination.A noter : les opérations de chargement et de déchargement doivent faire l'objet d'un document écrit, appelé "protocole de sécurité" qui remplace le plan de prévention. Le protocole de sécurité est encadré par les articles R4515-4 et suivants du Code du travail (lien hypertexte). Bien qu'ils soient dispensés d'une inspection commune préalable, l'entreprise d'accueil et l'entreprise de transport doivent néanmoins échanger toutes les informations nécessaires au bon déroulement des opérations.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4515-4 du Code du travail
Les dispositions relatives aux entreprises utilisatrices et extérieures ont été simplifiées en ce qui concerne les opérations de chargement et de déchargement : pour ces opérations, l'établissement d'un protocole de sécurité remplace le plan de prévention. Un protocole de sécurité est un document obligatoirement écrit qui doit être établi (quelle que soit la durée de l’opération) entre l’entreprise d'accueil et l’entreprise de transport préalablement à l'opération de chargement et de déchargement. On y trouve toutes les indications utiles à l’évaluation des risques générés par l’opération de chargement et de déchargement des marchandises, ainsi que les mesures de de prévention et de sécurité mises en place à chaque phase de l'opération. Les articles R4515-6 et R4515-7 listent par ailleurs les informations obligatoires à renseigner dans le protocole de sécurité incombant à chacune des entreprises.Le protocole de sécurité doit prendre en compte l’intégralité des tâches à réaliser et s’applique à une situation précise (attention à ce que le protocole de sécurité n'énonce pas une suite de généralités éloignée de la réalité de l’entreprise).Le protocole doit préciser clairement ce qui est à la charge de l’entreprise utilisatrice et ce qui relève de l’entreprise de transport pour éviter tout risque lié à la co-activité. D'une manière générale, le chef de l’entreprise d’accueil doit coordonner les mesures arrêtées avec les chefs des entreprises de transport. Cela en vue de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et les matériels des différentes entreprises présentes sur le lieu de l'opération. A noter : Le transporteur qui va charger la marchandise chez un client A (chargeur) doit se conformer au protocole de sécurité en vigueur chez le client A. Le transporteur qui va ensuite livrer la marchandise chez un client B doit se conformer au protocole de sécurité en vigueur chez le client B.Par conséquent, un chauffeur qui va charger des marchandises dans un site A et va les décharger sur un site B a donc deux protocoles de sécurité à connaitre et à respecter (clients A et B). Son employeur participe donc à l’élaboration et à la signature de deux protocoles de sécurité.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d’évaluation de l’état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l’amiante et au contenu du rapport de repérage
A noter, le plan de prévention, établi lors de la phase préalable, doit intégrer le risque amiante dans l'organisation générale de la prévention.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
A noter, le plan de prévention, établi lors de la phase préalable doit intégrer le risque amiante dans l'organisation générale de la prévention.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article 3 de l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
A noter, le plan de prévention doit intégrer le risque amiante dans l'organisation générale de la prévention.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article 9 de l'arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques
...

Droit de la prévention
24 mai 2024Annexe I de l'arrêté du 27 novembre 2013 relatif aux entreprises intervenant au sein d'établissements exerçant des activités nucléaires et des entreprises de travail temporaire concernées par ces activités
L'arrêté du 27 novembre 2013 impose des exigences spécifiques aux entreprises extérieures qui interviennent dans un établissement exerçant des activités nucléaires.En situation de coactivité, afin de s'assurer de la protection effective des travailleurs contre les risques radiologiques, le présent arrêté fixe les exigences spécifiques relatives à l'organisation du travail et de la radioprotection des travailleurs. Cet arrêté définit également la procédure de certification requise pour les entreprises concernées.Cette annexe I de l'arrêté du 27 novembre 2013 fixe les exigences particulières applicables aux entreprises extérieures, hors entreprises de travail temporaire.Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification qui fait la demande de certification adresse à l'organisme certificateur les informations nécessaires à l'instruction du dossier.Il les met à jour en tant que de besoin et les transmet à l'organisme certificateur dans le cadre des audits de surveillance ou de renouvellement.1. Exigences relatives à l'organisation et aux moyens de prévention des risquesAutant que faire se peut, pour respecter ces exigences, l'entreprise soumise à l'obligation de certification privilégie une approche organisationnelle concertée avec les principaux acteurs concernés et s'efforce de limiter les obligations documentaires supplémentaires.1.1. Définition d'une politique de prévention des risques de rayonnements ionisantsLe chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification définit, en cohérence avec sa politique générale de prévention des risques professionnels, une politique de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants appropriée à la nature et à l'étendue des risques liés à ses activités. Cette politique, donnant lieu à des mesures de prévention, est documentée, mise en œuvre, maintenue et communiquée à tout le personnel concerné.En application de cette politique, il définit les procédures de mise en œuvre des mesures de prévention qu'il a fixées au regard des activités qu'il conduit. Ces procédures décrivent notamment :- l'organisation des mesures de prévention lors des opérations, notamment les informations à transmettre aux travailleurs, les modalités d'accès au lieu d'opération, les modalités de mise à disposition et d'entretien des équipements de protection individuelle... ;- l'organisation de l'opération (telle que l'élaboration de procédures de travail, du planning d'exécution des tâches ou les moyens mis à disposition par l'entreprise d'accueil), et notamment les dispositions permettant la communication et l'appropriation par les salariés des éléments nécessaires à la sécurité de l'opération ;- l'organisation de la radioprotection permettant de maintenir l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, notamment en garantissant une propreté radiologique des lieux d'opération ;- la définition des compétences en radioprotection nécessaires à la gestion des opérations réalisées ;- en cas de situations particulières, les mesures de radioprotection spécifiques à mettre en œuvre ;- l'organisation permettant de prendre en compte, à des fins d'amélioration continue, le retour d'expérience comprenant celui de ses sous-traitants et les résultats des audits internes et revues de direction réalisées ;- les moyens mis en place pour assurer la veille réglementaire ;- les moyens mis en place pour garantir la traçabilité des mesures mises en œuvre en application de cette politique ;- les conditions d'externalisation de la fonction de personne compétente en radioprotection.Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification définit également des programmes et objectifs annuels et par opération relatifs à la radioprotection (dose, contamination...). Ces objectifs sont fixés et revus en fonction de l'activité.1.2. Evaluation des risques en vue de l'opérationLe chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure, à l'occasion de l'inspection commune préalable, ou en amont de celle-ci lorsque la situation le nécessite, et à l'occasion de l'établissement du plan de prévention ou du plan particulier de sécurité et de protection de la santé, de la prise en compte des risques liés à son activité ainsi que de l'ensemble des risques d'interférence liés à la coactivité.A cet effet, il :- recueille les attentes du chef de l'entreprise d'accueil, notamment en matière de programmation des opérations définies ;- recueille auprès du chef de l'entreprise d'accueil les informations nécessaires à la mise en œuvre de sa politique de prévention des risques professionnels ;- identifie, pour les opérations relevant de sa compétence, les éventuels recours nécessaires à la sous-traitance et en informe le chef de l'entreprise d'accueil ;- organise la participation de la personne compétente en radioprotection qu'il a désignée à l'inspection commune préalable. Lorsque celle-ci ne peut y participer à titre exceptionnel, une personne techniquement compétente placée sous son autorité peut la remplacer et accompagner le représentant légal de l'entreprise à cette inspection ;- définit les procédures permettant à la personne compétente en radioprotection qu'il a désignée d'être informée des dispositions particulières prises par l'entreprise d'accueil en matière de radioprotection ;- réalise l'analyse des postes de travail mentionnée à l'article R. 4451-11, prenant en compte les situations de travail considérées ;- met à jour la fiche d'exposition mentionnée à l'article R. 4451-57 conformément aux situations de travail considérées ;- définit des moyens de protection collective et équipements de protection individuelle ;- s'assure de la compatibilité de la dosimétrie prévisionnelle individuelle et collective avec les niveaux de dose déjà reçus par les travailleurs au cours des douze derniers mois ;- prend en compte les risques de contamination et de dispersion.1.3. Mise en œuvre des mesures de prévention des risquesPour l'entreprise qui n'a jamais exercé ou n'a pas exercé, au cours des douze derniers mois, d'activité entrant dans le champ d'application de la certification prévue par le présent arrêté, le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification apporte la preuve de sa capacité à mettre en œuvre les dispositions suivantes, notamment en appliquant celles possibles à un nombre restreint de travailleurs.1.3.1. Application de la politique de prévention des risquesSur le fondement de l'évaluation des risques, le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure de la bonne application des mesures de prévention qu'il a définies dans sa politique et notamment que :- la planification des opérations, leur nature, les éléments relatifs aux effectifs et aux matériels ont été communiqués à la personne en charge de l'encadrement des opérations sur le lieu d'opération et au chef de l'entreprise d'accueil ;- les éléments mentionnés dans le plan de prévention ou dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé correspondent à ceux existant à l'ouverture du chantier et au cours de celui-ci ;- les équipements de travail, les moyens de protection collective, les équipements de protection individuelle et les moyens de mesure de l'exposition individuelle sont adaptés aux circonstances particulières de l'opération, entretenus, mis à disposition des travailleurs intervenant et que ces derniers ont bénéficié de la formation à l'utilisation de ces équipements.1.3.2. Communication aux salariésIl veille à ce que soient transmises aux salariés qu'il emploie, comprises et respectées :- les durées maximales de port des équipements de protection individuelle ;- les procédures d'affichage relatif à la sécurité au travail lui incombant ;- les procédures de gestion des matériels contaminés ;- les règles de mise en œuvre de la dosimétrie, externe ou interne, ainsi que celles concernant la communication des résultats dosimétriques ;- les conditions et modalités de mise à disposition de sources de rayonnements ionisants.1.3.3. Compétences et moyens des personnes chargées de la mise en œuvre de la prévention des risquesLe chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure également que :- la personne en charge de l'encadrement des opérations sur le lieu de l'opération dispose :- de l'autorité nécessaire pour prendre en compte les situations particulières qui pourraient lui être mentionnées par le chef de l'entreprise d'accueil et corriger les écarts relevés entre les exigences définies contractuellement et la situation existante. Pour les écarts concernant la radioprotection des travailleurs, il prend préalablement l'avis de la personne compétente en radioprotection de son entreprise ;- de l'autorité nécessaire pour prendre en compte, le cas échéant, les observations que le chef de l'entreprise d'accueil formulerait en application de l'article L. 4522-1 du code du travail ;- du temps nécessaire pour participer aux inspections et réunions périodiques organisées par l'entreprise d'accueil et de l'autorité suffisante pour solliciter ces réunions aux fins d'assurer la coordination des mesures de prévention ;- de l'appui de la personne compétente en radioprotection ou, lorsque celle-ci ne peut se rendre disponible à titre exceptionnel, d'une personne techniquement compétente, placée sous l'autorité de celle-ci, pour organiser la prévention des risques ou traiter les écarts observés entre le prévisionnel et le constaté ;- des compétences nécessaires pour adapter, en cas de besoin, aux risques spécifiques de l'opération les procédures préalablement définies, notamment en matière de radioprotection ;- des moyens nécessaires pour, en cas d'écart, notamment d'événements significatifs au sens des articles R. 4451-99 et suivants, rétablir les conditions de sécurité ;- la personne compétente en radioprotection dispose :- d'un certificat adapté au secteur d'activité et à la nature du risque concernés ;- du temps et des moyens suffisants pour assumer ses missions, notamment organiser la formation à la radioprotection des travailleurs, la dosimétrie de ces derniers, en particulier pour ce qui concerne la mise à disposition des dosimètres de référence et des dosimètres opérationnels ainsi que la transmission des résultats aux acteurs concernés ;- d'un accès au système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants ;- d'une connaissance de l'installation nucléaire dans laquelle elle intervient ;- le médecin du travail dispose d'un accès au système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants.Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification met en place une organisation qui assure la confidentialité des données dosimétriques transmises en concertation avec le chef de l'entreprise d'accueil.1.3.4. Connaissances et compétences des travailleursLe chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification organise, pour chaque opération, la répartition des tâches entre les différents intervenants, définit leurs obligations et s'assure qu'ils en ont été informés.Il s'assure, sur le fondement du résultat de l'évaluation des risques et compte tenu des moyens de prévention mis en œuvre :- de l'adéquation des compétences des travailleurs avec les missions qui leur ont été confiées, notamment en ce qui concerne la radioprotection ;- de leur connaissance de la nature des risques professionnels dus à la nature et au lieu de l'opération ;- de la validité de l'aptitude médicale des travailleurs aux situations considérées ;- de l'adéquation du classement A ou B et de la formation à la radioprotection des travailleurs conformément au point 1.3.5 ;- du respect des valeurs limites d'exposition, quels que soient les risques pour les travailleurs ;- des modalités de gestion du pro rata temporis des travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée ou temporaire ;- de la mise en place d'une procédure de gestion des situations :- anormales de travail telles que définies par le code du travail ;- en cas de dépassement des valeurs limites ;- de l'établissement des attestations d'exposition lors du départ des salariés de l'entreprise.1.3.5. Formation des travailleursLa formation dont bénéficient les travailleurs exposés de l'entreprise certifiée a pour objectifs de leur permettre :1. De se situer au sein de l'industrie nucléaire française.2. D'appréhender la radioactivité naturelle, artificielle et les risques radiologiques associés.3. D'identifier les principales sources de dangers conventionnels.4. De se protéger des risques professionnels, notamment de ceux liés à l'exposition aux rayonnements ionisants.5. De connaître les dispositions générales de prévention, notamment les procédures d'accès, de travail et de sortie des zones réglementées.6. De connaître les procédures spécifiques à l'entreprise liées à la réalisation d'opérations pour le compte d'une entreprise d'accueil.7. D'utiliser les équipements de protection individuelle, notamment savoir mettre et retirer une combinaison, des gants, etc.8. De réagir en situation dégradée conformément aux procédures fixées par l'entreprise.9. De connaître les procédures, propres à l'entreprise, pour l'identification et la prise en compte des retours d'expérience.Le chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification organise cette formation théorique et pratique, d'une durée permettant l'acquisition de ces objectifs pédagogiques, en s'appuyant sur des chantiers écoles et ponctuée d'une évaluation à l'issue de laquelle est délivré un certificat de réussite. Il peut confier cette formation à des organismes spécialisés.1.4. Consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travailLe chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure de l'information du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.2. Exigences relatives à la sous-traitance et au travail temporaire2.1. Cas particulier du recours à des sous-traitantsLe chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure que :- ses sous-traitants disposent de la certification prévue par le présent arrêté ;- ses sous-traitants disposent de tous les éléments relatifs aux opérations à réaliser et aux risques liés.2.2. Cas particulier du recours à des travailleurs temporairesLe chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification s'assure que :- l'entreprise de travail temporaire à laquelle il a recours dispose de la certification prévue par le présent arrêté ;- l'organisation mise en place permet au travailleur temporaire auquel il a recours de bénéficier de l'ensemble des mesures de prévention au même titre que les salariés de son entreprise, étant précisé que les dispositions relatives à la dosimétrie de référence et à l'examen médical d'embauche prévu à l'article R. 4625-9 relèvent de la compétence de l'entreprise de travail temporaire ;- la personne compétente en radioprotection de l'entreprise de travail temporaire reçoit communication des éléments relatifs à la dosimétrie prévisionnelle et à la dose reçue.3. Exigences relatives à la gestion des écarts par rapport aux procédures mises en place et actions correctivesLe chef de l'entreprise soumise à l'obligation de certification établit des procédures permettant de :- identifier, enregistrer et traiter les écarts aux procédures mises en place ;- analyser la situation ;- réaliser des actions pour atténuer toutes les conséquences de ces écarts, déclencher et appliquer des actions curatives et correctives ;- vérifier l'efficacité des actions curatives et correctives menées.
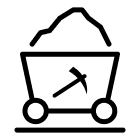
Droit de la prévention
16 avril 2024Article 1er du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
L'intervention d'une entreprise extérieure pour des opérations dans les mines et carrières était initialement encadrée par le RGIE (Règlement Général des Industries Extractives). Ce dernier étant progressivement en cours d'abrogation, la partie IV du Code du Travail relative à la santé et la sécurité au travail s'applique désormais aux mines et carrières.Les dispositions générales du Code du travail relatives aux entreprises extérieures sont ainsi applicables aux interventions d'entreprises extérieures dans les mines et carrières (ex : le plan de prévention), des spécificités sont toutefois apportées par le décret n°2019-574 du 11 juin 2019 (ex : le permis de travail).
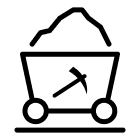
Droit de la prévention
16 avril 2024Article 2 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
Lorsqu'un salarié d'une entreprise extérieure est amené à réaliser des travaux dangereux dans des mines, carrières ou dans leurs dépendances, l'employeur (entreprise extérieure) doit établir un permis de travail.Ce permis de travail doit attester les compétences détenues par le travailleur pour accomplir des travaux dangereux, préciser les précautions à prendre avant, pendant et après ces travaux, et, si nécessaire, faire état de l'aptitude du travailleur sur le plan médical.Le permis de travail du travailleur est communiqué à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise extérieure.Un arrêté du 11 juin 2019 fixe une liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels un permis de travail, et par ailleurs un plan de prévention écrit, doivent être établis. Cette liste s'ajoute à celle des travaux dangereux fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 pris en application de l'article R4512-7 du Code du travail.
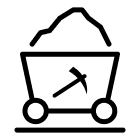
Droit de la prévention
16 avril 2024Article 3 du décret n° 2019-574 du 11 juin 2019 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et aux carrières en matière d'entreprises extérieures
Le permis de travail du travailleur doit être communiqué par l'entreprise extérieure à l'entreprise utilisatrice, au même titre que les informations prévues à l'article R4511-10 du Code du travail, à savoir la date d'arrivée de l'entreprise extérieure et la durée prévisible de l'intervention, le nombre prévisible de travailleurs affectés ou encore l'identification des sous-traitants et des travaux sous-traités.Pour mémoire, lorsqu'un salarié d'une entreprise extérieure est amené à réaliser des travaux dangereux dans des mines et carrières de l'entreprise utilisatrice, son employeur doit lui délivrer un permis de travail. Ce permis de travail doit attester les compétences détenues par le travailleur pour accomplir des travaux dangereux, préciser les précautions à prendre avant, pendant et après ces travaux, et, si nécessaire, faire état de l'aptitude du travailleur sur le plan médical.Un arrêté du 11 juin 2019 fixe une liste complémentaire des travaux dangereux dans les mines et carrières pour lesquels un permis de travail et un plan de prévention écrit doivent être établis. Cette liste s'ajoute à celle des travaux dangereux fixée par l'arrêté du 19 mars 1993 pris en application de l'article R4512-7 du Code du travail.
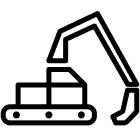
Droit de la prévention
19 janvier 2024Article R4323-36 du Code du travail
Conformément aux principes généraux de prévention prévus par l'article L4121-2 du Code du travail, l'employeur doit en priorité éviter le risque et donc éviter que ses salariés se retrouvent en dessous de charges déplacées par un équipement de levage. L'employeur identifie une zone de sécurité correspondant à un cône dans lequel chuterait l'objet. Le diamètre de base de ce cône est égal à la hauteur entre le crochet et le niveau où se déplace le salarié. Un mode opératoire (PPSPS, plan de prévention...) doit détailler les mesures de prévention prises par l'employeur.
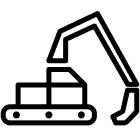
Droit de la prévention
16 janvier 2024Article 5 de l'arrêté du 2 décembre 1998 fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les équipements de levage de charge pour pouvoir être utilisés pour le levage de personnes
L'article R4323-32 du Code du travail autorise l'utilisation d'un équipement de travail pour le levage de personnes alors qu'il n'est pas prévu pour cette utilisation pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose ces personnes à un risque plus important lié à l'environnement de travail. L'analyse de risques réalisée par l'employeur doit démontrer que cette solution est la seule possible. Pour que l'équipement puisse être utilisé pour le levage de personnes, l'employeur doit notamment avoir pris les dispositions nécessaires pour assurer l'évacuation des personnes se situant dans l'habitacle en cas de danger. Nota : Ces mesures doivent être prévues dans le plan de prévention ou dans PPSPS.
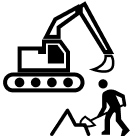
Droit de la prévention
18 avril 2023Article R4461-11 du Code du travail
Lorsqu'une entreprise en activité fait intervenir une entreprise extérieure pour réaliser des travaux sur ses installations, le chef d'établissement de l'entreprise en activité doit définir un plan de prévention, conjointement avec l'entreprise intervenante et après une inspection préalable du site, afin de définir les mesures de prévention commune et de réduire les risques liés à la coactivité entre l'entreprise et les compagnons extérieurs intervenant.Quand l'entreprise en activité dispose de consignes particulières en matière de risque hyperbare, elles doivent ête communiquées à toute entreprise extérieure ou travailleur indépendant intervenant sur le site.L'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure sont chacune responsable de la prévention collective et individuelle de ses salariés, et reste en charge de la mise à disposition et de l'entreprise des équipements fournis à ses salariés, sauf accord écrit entre les entreprises pour s'organiser autrement.
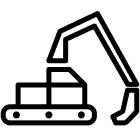
Droit de la prévention
13 avril 2023Article L6131-1 du Code des transports
La responsabilité de l’exploitant d’un drone et de son télépilote peut être recherchée en cas de dommage causé par l’appareil à un autre aéronef en vol (et notamment sur le fondement de la responsabilité civile du fait des choses que l’on a sous sa garde). L’exploitant est, en revanche, tenu responsable de plein droit des dommages causés lors du vol de son drone aux personnes ou aux biens situés au sol (seule une faute de la victime peut atténuée ou écartée la responsabilité de l’exploitant).A noter, en cas de location d’un drone, le propriétaire et l’exploitant sont responsables solidairement en cas de dommages causés aux tiers (sauf si la location est enregistrée au registre d’immatriculation, dans ce cas le propriétaire est responsable uniquement s’il a commis une faute).Il conviendra pour l’exploitant et le télépilote de vérifier les conditions dans lesquelles leurs activités sont assurées, via leur contrat de responsabilité civile ou via une assurance spécifique.Utilisation d’un drone en situation de co-activité :L’utilisation d’un drone pouvant entrainer des risques (ex : collision, chute, interférence), ceux-ci doivent être pris en compte dans le cadre des opérations de bâtiment ou de génie civil réalisées en situation de co-activité car ces risques s’ajoutent aux risques de l’opération de construction.Cette prise en compte peut se faire à plusieurs niveaux selon l’opérateur qui utilise le drone :Utilisation d’un drone à l’initiative du maitre d’ouvrage ou du maître d’œuvre : intégration dans le Plan général de coordination SPS (PGC) par le Coordonnateur SPS ;Utilisation d’un drone par une entreprise intervenant sur le chantier : intégration dans le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) de l’entreprise, et prise en compte dans le PGC ;Utilisation d’un drone par un prestataire à l’initiative d’une entreprise intervenant sur le chantier : intégration dans le PPSPS de l’entreprise donneur d’ordre ayant demandé l’intervention de ce prestataire, et prise en compte dans le PGC ;Utilisation d’un drone par une entreprise sous-traitante : intégration dans le PPSPS de l’entreprise sous-traitante, et prise en compte dans le PGC.Lorsqu’un drone est utilisé dans le cadre d’un établissement en activité, ou bien sur ses dépendances ou chantiers, l’entreprise extérieure et l’entreprise utilisatrice doivent tenir compte des risques engendrés par cette utilisation dans le plan de prévention.
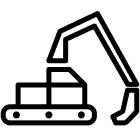
Droit de la prévention
13 avril 2023Article L6131-2 du Code des transports
La responsabilité de l’exploitant d’un drone et de son télépilote peut être recherchée en cas de dommage causé par l’appareil à un autre aéronef en vol (et notamment sur le fondement de la responsabilité civile du fait des choses que l’on a sous sa garde). L’exploitant est, en revanche, tenu responsable de plein droit des dommages causés lors du vol de son drone aux personnes ou aux biens situés au sol (seule une faute de la victime peut atténuée ou écartée la responsabilité de l’exploitant).A noter, en cas de location d’un drone, le propriétaire et l’exploitant sont responsables solidairement en cas de dommages causés aux tiers (sauf si la location est enregistrée au registre d’immatriculation, dans ce cas le propriétaire est responsable uniquement s’il a commis une faute).Il conviendra pour l’exploitant et le télépilote de vérifier les conditions dans lesquelles leurs activités sont assurées, via leur contrat de responsabilité civile ou via une assurance spécifique.Utilisation d’un drone en situation de co-activité :L’utilisation d’un drone pouvant entrainer des risques (ex : collision, chute, interférence), ceux-ci doivent être pris en compte dans le cadre des opérations de bâtiment ou de génie civil réalisées en situation de co-activité car ces risques s’ajoutent aux risques de l’opération de construction.Cette prise en compte peut se faire à plusieurs niveaux selon l’opérateur qui utilise le drone :Utilisation d’un drone à l’initiative du maitre d’ouvrage ou du maître d’œuvre : intégration dans le Plan général de coordination SPS (PGC) par le Coordonnateur SPS ;Utilisation d’un drone par une entreprise intervenant sur le chantier : intégration dans le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) de l’entreprise, et prise en compte dans le PGC ;Utilisation d’un drone par un prestataire à l’initiative d’une entreprise intervenant sur le chantier : intégration dans le PPSPS de l’entreprise donneur d’ordre ayant demandé l’intervention de ce prestataire, et prise en compte dans le PGC ;Utilisation d’un drone par une entreprise sous-traitante : intégration dans le PPSPS de l’entreprise sous-traitante, et prise en compte dans le PGC.Lorsqu’un drone est utilisé dans le cadre d’un établissement en activité, ou bien sur ses dépendances ou chantiers, l’entreprise extérieure et l’entreprise utilisatrice doivent tenir compte des risques engendrés par cette utilisation dans le plan de prévention.
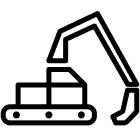
Droit de la prévention
13 avril 2023Article L6131-4 du Code des transports
La responsabilité de l’exploitant d’un drone et de son télépilote peut être recherchée en cas de dommage causé par l’appareil à un autre aéronef en vol (et notamment sur le fondement de la responsabilité civile du fait des choses que l’on a sous sa garde). L’exploitant est, en revanche, tenu responsable de plein droit des dommages causés lors du vol de son drone aux personnes ou aux biens situés au sol (seule une faute de la victime peut atténuée ou écartée la responsabilité de l’exploitant).A noter, en cas de location d’un drone, le propriétaire et l’exploitant sont responsables solidairement en cas de dommages causés aux tiers (sauf si la location est enregistrée au registre d’immatriculation, dans ce cas le propriétaire est responsable uniquement s’il a commis une faute).Il conviendra pour l’exploitant et le télépilote de vérifier les conditions dans lesquelles leurs activités sont assurées, via leur contrat de responsabilité civile ou via une assurance spécifique.Utilisation d’un drone en situation de co-activité :L’utilisation d’un drone pouvant entrainer des risques (ex : collision, chute, interférence), ceux-ci doivent être pris en compte dans le cadre des opérations de bâtiment ou de génie civil réalisées en situation de co-activité car ces risques s’ajoutent aux risques de l’opération de construction.Cette prise en compte peut se faire à plusieurs niveaux selon l’opérateur qui utilise le drone :Utilisation d’un drone à l’initiative du maitre d’ouvrage ou du maître d’œuvre : intégration dans le Plan général de coordination SPS (PGC) par le Coordonnateur SPS ;Utilisation d’un drone par une entreprise intervenant sur le chantier : intégration dans le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) de l’entreprise, et prise en compte dans le PGC ;Utilisation d’un drone par un prestataire à l’initiative d’une entreprise intervenant sur le chantier : intégration dans le PPSPS de l’entreprise donneur d’ordre ayant demandé l’intervention de ce prestataire, et prise en compte dans le PGC ;Utilisation d’un drone par une entreprise sous-traitante : intégration dans le PPSPS de l’entreprise sous-traitante, et prise en compte dans le PGC.Lorsqu’un drone est utilisé dans le cadre d’un établissement en activité, ou bien sur ses dépendances ou chantiers, l’entreprise extérieure et l’entreprise utilisatrice doivent tenir compte des risques engendrés par cette utilisation dans le plan de prévention.

Droit de la prévention
26 septembre 2022Article R4532-48 du Code du travail
Le contenu du PGC SPS est défini de façon très précise. Selon la circulaire DRT 96-5 du 10 avril 1996 le PGC SPS a un rôle de stratégie générale ou de "planification" appliquée à l'opération (au sens des principes généraux de prévention) et d'harmonisation des différentes procédures. Il est joint au dossier de consultation des entreprises.Le PGC SPS permet de mettre en place de façon très concrète la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur le chantier qui sera adaptée en fonction de l'opération.Le PGC SPS intègre les mesures liées à la coactivité mentionnées dans les PPSPS des différentes entreprise en les harmonisant.Cette harmonisation permet de prendre en compte :- la cohérence entre le PGC SPS et les PPSPS- la compatibilité des interventions simultanées et successives en matière de coactivitéDans le cadre d'une opération dans un site en exploitation, le PGC SPS intègrera le plan de prévention en l'harmonisant.Cette harmonisation permet de prendre en compte :- la cohérence entre le PGC SPS et le Plan de Prévention, notamment dans les mesures de prévention à mettre en oeuvre dans le cadre de l'exposition aux risques liés à l'exploitation, mais également des contraintes internes au site comme les mesures d'accès ou les procédures de secours.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4511-1 du Code du travail
La réglementation relative au plan de prévention, prévues aux articles R4511-1 à R4514-10 du Code du travail s'appliquent dès lors qu'une ou des entreprises extérieures fait intervenir leurs travailleurs pour exécuter une opération dans un établissement d'une autre entreprise, dite entreprise utilisatrice.En revanche, ces articles ne s'appliquent pas :- aux travaux de construction et de réparation navale ;- aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (coordination SPS). Ces chantiers répondent à une réglementation spécifique fixée aux articles R4532-1 et suivants du Code du travail (voir onglet "Coordination opération de bâtiment"). Toutefois, en présence d'un chantier de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination SPS dans l'enceinte de son entreprise, le chef de l'entreprise utilisatrice doit coopérer avec le coordonnateur SPS.A noter, les opérations de chargement et de déchargement donnent lieu à un protocole de sécurité et font l'objet de dispositions spécifiques prévues aux articles R4515-1 et suivants du Code du travail (LIEN).La circulaire DRT n°93-14 du 18 mars 1993 précise les définitions des termes utilisés sur ce sujet:- Entreprise extérieure : toute entreprise juridiquement indépendante de l'entrepriseutilisatrice amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans leslocaux d'une autre entreprise utilisatrice, qu'il y ait ou non une relation contractuelle entrel'entreprise utilisatrice et cette entreprise. Cette entreprise extérieure peut être une entrepriseintervenante ou une entreprise sous-traitante.- Entreprise utilisatrice : il s'agit de l'entreprise « d'accueil » où l'opération est effectuée par dupersonnel appartenant à d'autres entreprises, lorsque ce personnel n'est pas complètement soussa direction (le travail temporaire est exclu), qu'il y ait ou non une relation contractuelle avecles entreprises extérieures intervenantes ou sous-traitantes. L'entreprise utilisatrice n'est pasobligatoirement propriétaire des lieux.- Etablissement, dépendances et chantiers de l'entreprise utilisatrice : le terme d'établissement est ici compris, au sens de la prévention, comme une unité de travail (il ne correspond pas nécessairement à la notion d'établissement administratif auquel sont rattachés les salariés par exemple).Les dépendances et les chantiers concernés sont ceux situés à proximité immédiate de l'établissement, mais pas seulement. Il peut également s'agir d'ouvrages éloignés en fonctionnement sur lesquels l'entreprise utilisatrice a la maitrise juridique et dans lesquels elle déploie une fraction de son activité (ex : réseaux enterrés, conduite de gaz...).D'une manière générale, il s'agit des dépendances et chantiers sur lesquels il existe des interférences d'activités (c'est-à-dire notamment présence sur un même lieu du personnel de l'entreprise utilisatrice et du personnel des entreprises extérieures), d'installations et de matériel (c'est-à-dire présence en un même lieu d'installations et matériels des entreprises extérieures et de l'entreprise utilisatrice).- Opération : L'opération se définit comme « une suite ordonnée d'actes qui suppose une méthode, une combinaison, une recherche de moyens en vue de produire un résultat précis ». Au sens du décret n°92-158 du 20 février 1992, l'opération est constituée soit par une prestation, soit par un ensemble de prestations de services ou des travaux assurés par une ou des entreprises extérieures intervenantes (ou sous-traitantes) en vue de concourir à un même objectif. Il peut s'agir par exemple de la réfection d'un atelier, de l'installation ou la maintenance d'un équipement de travail, d'une intervention sur toiture ou encore sur un réseau électrique.Vous trouverez ICI un schéma de la réglementation applicable en situation de coactivité distinguant l'intervention d'une entreprise extérieure d'une opération de BTP sur un chantier.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4511-2 du Code du travail
La réglementation relative au plan de prévention, prévues aux articles R4511-1 à R4514-10 du Code du travail s'appliquent dès lors qu'une ou des entreprises extérieures fait intervenir leurs travailleurs pour exécuter une opération dans un établissement d'une autre entreprise, dite entreprise utilisatrice.En revanche, ces articles ne s'appliquent pas :- aux travaux de construction et de réparation navale ;- aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (coordination SPS). Ces chantiers répondent à une réglementation spécifique fixée aux articles R4532-1 et suivants du Code du travail (voir onglet "Coordination opération de bâtiment"). Toutefois, en présence d'un chantier de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination SPS dans l'enceinte de son entreprise, le chef de l'entreprise utilisatrice doit coopérer avec le coordonnateur SPS.A noter, les opérations de chargement et de déchargement donnent lieu à un protocole de sécurité et font l'objet de dispositions spécifiques prévues aux articles R4515-1 et suivants du Code du travail (LIEN).La circulaire DRT n°93-14 du 18 mars 1993 précise les définitions des termes utilisés sur ce sujet:- Entreprise extérieure : toute entreprise juridiquement indépendante de l'entrepriseutilisatrice amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans leslocaux d'une autre entreprise utilisatrice, qu'il y ait ou non une relation contractuelle entrel'entreprise utilisatrice et cette entreprise. Cette entreprise extérieure peut être une entrepriseintervenante ou une entreprise sous-traitante.- Entreprise utilisatrice : il s'agit de l'entreprise « d'accueil » où l'opération est effectuée par dupersonnel appartenant à d'autres entreprises, lorsque ce personnel n'est pas complètement soussa direction (le travail temporaire est exclu), qu'il y ait ou non une relation contractuelle avecles entreprises extérieures intervenantes ou sous-traitantes. L'entreprise utilisatrice n'est pasobligatoirement propriétaire des lieux.- Etablissement, dépendances et chantiers de l'entreprise utilisatrice : le terme d'établissement est ici compris, au sens de la prévention, comme une unité de travail (il ne correspond pas nécessairement à la notion d'établissement administratif auquel sont rattachés les salariés par exemple).Les dépendances et les chantiers concernés sont ceux situés à proximité immédiate de l'établissement, mais pas seulement. Il peut également s'agir d'ouvrages éloignés en fonctionnement sur lesquels l'entreprise utilisatrice a la maitrise juridique et dans lesquels elle déploie une fraction de son activité (ex : réseaux enterrés, conduite de gaz...).D'une manière générale, il s'agit des dépendances et chantiers sur lesquels il existe des interférences d'activités (c'est-à-dire notamment présence sur un même lieu du personnel de l'entreprise utilisatrice et du personnel des entreprises extérieures), d'installations et de matériel (c'est-à-dire présence en un même lieu d'installations et matériels des entreprises extérieures et de l'entreprise utilisatrice).- Opération : L'opération se définit comme « une suite ordonnée d'actes qui suppose une méthode, une combinaison, une recherche de moyens en vue de produire un résultat précis ». Au sens du décret n°92-158 du 20 février 1992, l'opération est constituée soit par une prestation, soit par un ensemble de prestations de services ou des travaux assurés par une ou des entreprises extérieures intervenantes (ou sous-traitantes) en vue de concourir à un même objectif. Il peut s'agir par exemple de la réfection d'un atelier, de l'installation ou la maintenance d'un équipement de travail, d'une intervention sur toiture ou encore sur un réseau électrique.Vous trouverez ICI un schéma de la réglementation applicable en situation de coactivité distinguant l'intervention d'une entreprise extérieure d'une opération de BTP sur un chantier.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4511-3 du Code du travail
La réglementation relative au plan de prévention, prévues aux articles R4511-1 à R4514-10 du Code du travail s'appliquent dès lors qu'une ou des entreprises extérieures fait intervenir leurs travailleurs pour exécuter une opération dans un établissement d'une autre entreprise, dite entreprise utilisatrice.En revanche, ces articles ne s'appliquent pas :- aux travaux de construction et de réparation navale ;- aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (coordination SPS). Ces chantiers répondent à une réglementation spécifique fixée aux articles R4532-1 et suivants du Code du travail (voir onglet "Coordination opération de bâtiment"). Toutefois, en présence d'un chantier de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination SPS dans l'enceinte de son entreprise, le chef de l'entreprise utilisatrice doit coopérer avec le coordonnateur SPS.A noter, les opérations de chargement et de déchargement donnent lieu à un protocole de sécurité et font l'objet de dispositions spécifiques prévues aux articles R4515-1 et suivants du Code du travail (LIEN).La circulaire DRT n°93-14 du 18 mars 1993 précise les définitions des termes utilisés sur ce sujet:- Entreprise extérieure : toute entreprise juridiquement indépendante de l'entrepriseutilisatrice amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans leslocaux d'une autre entreprise utilisatrice, qu'il y ait ou non une relation contractuelle entrel'entreprise utilisatrice et cette entreprise. Cette entreprise extérieure peut être une entrepriseintervenante ou une entreprise sous-traitante.- Entreprise utilisatrice : il s'agit de l'entreprise « d'accueil » où l'opération est effectuée par dupersonnel appartenant à d'autres entreprises, lorsque ce personnel n'est pas complètement soussa direction (le travail temporaire est exclu), qu'il y ait ou non une relation contractuelle avecles entreprises extérieures intervenantes ou sous-traitantes. L'entreprise utilisatrice n'est pasobligatoirement propriétaire des lieux.- Etablissement, dépendances et chantiers de l'entreprise utilisatrice : le terme d'établissement est ici compris, au sens de la prévention, comme une unité de travail (il ne correspond pas nécessairement à la notion d'établissement administratif auquel sont rattachés les salariés par exemple).Les dépendances et les chantiers concernés sont ceux situés à proximité immédiate de l'établissement, mais pas seulement. Il peut également s'agir d'ouvrages éloignés en fonctionnement sur lesquels l'entreprise utilisatrice a la maitrise juridique et dans lesquels elle déploie une fraction de son activité (ex : réseaux enterrés, conduite de gaz...).D'une manière générale, il s'agit des dépendances et chantiers sur lesquels il existe des interférences d'activités (c'est-à-dire notamment présence sur un même lieu du personnel de l'entreprise utilisatrice et du personnel des entreprises extérieures), d'installations et de matériel (c'est-à-dire présence en un même lieu d'installations et matériels des entreprises extérieures et de l'entreprise utilisatrice).- Opération : L'opération se définit comme « une suite ordonnée d'actes qui suppose une méthode, une combinaison, une recherche de moyens en vue de produire un résultat précis ». Au sens du décret n°92-158 du 20 février 1992, l'opération est constituée soit par une prestation, soit par un ensemble de prestations de services ou des travaux assurés par une ou des entreprises extérieures intervenantes (ou sous-traitantes) en vue de concourir à un même objectif. Il peut s'agir par exemple de la réfection d'un atelier, de l'installation ou la maintenance d'un équipement de travail, d'une intervention sur toiture ou encore sur un réseau électrique.Vous trouverez ICI un schéma de la réglementation applicable en situation de coactivité distinguant l'intervention d'une entreprise extérieure d'une opération de BTP sur un chantier.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4511-4 du Code du travail
La réglementation relative au plan de prévention, prévues aux articles R4511-1 à R4514-10 du Code du travail s'appliquent dès lors qu'une ou des entreprises extérieures fait intervenir leurs travailleurs pour exécuter une opération dans un établissement d'une autre entreprise, dite entreprise utilisatrice.En revanche, ces articles ne s'appliquent pas :- aux travaux de construction et de réparation navale ;- aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (coordination SPS). Ces chantiers répondent à une réglementation spécifique fixée aux articles R4532-1 et suivants du Code du travail (voir onglet "Coordination opération de bâtiment"). Toutefois, en présence d'un chantier de bâtiment ou de génie civil soumis à l'obligation de coordination SPS dans l'enceinte de son entreprise, le chef de l'entreprise utilisatrice doit coopérer avec le coordonnateur SPS.A noter, les opérations de chargement et de déchargement donnent lieu à un protocole de sécurité et font l'objet de dispositions spécifiques prévues aux articles R4515-1 et suivants du Code du travail (LIEN).La circulaire DRT n°93-14 du 18 mars 1993 précise les définitions des termes utilisés sur ce sujet:- Entreprise extérieure : toute entreprise juridiquement indépendante de l'entrepriseutilisatrice amenée à faire travailler son personnel ponctuellement ou en permanence dans leslocaux d'une autre entreprise utilisatrice, qu'il y ait ou non une relation contractuelle entrel'entreprise utilisatrice et cette entreprise. Cette entreprise extérieure peut être une entrepriseintervenante ou une entreprise sous-traitante.- Entreprise utilisatrice : il s'agit de l'entreprise « d'accueil » où l'opération est effectuée par dupersonnel appartenant à d'autres entreprises, lorsque ce personnel n'est pas complètement soussa direction (le travail temporaire est exclu), qu'il y ait ou non une relation contractuelle avecles entreprises extérieures intervenantes ou sous-traitantes. L'entreprise utilisatrice n'est pasobligatoirement propriétaire des lieux.- Etablissement, dépendances et chantiers de l'entreprise utilisatrice : le terme d'établissement est ici compris, au sens de la prévention, comme une unité de travail (il ne correspond pas nécessairement à la notion d'établissement administratif auquel sont rattachés les salariés par exemple).Les dépendances et les chantiers concernés sont ceux situés à proximité immédiate de l'établissement, mais pas seulement. Il peut également s'agir d'ouvrages éloignés en fonctionnement sur lesquels l'entreprise utilisatrice a la maitrise juridique et dans lesquels elle déploie une fraction de son activité (ex : réseaux enterrés, conduite de gaz...).D'une manière générale, il s'agit des dépendances et chantiers sur lesquels il existe des interférences d'activités (c'est-à-dire notamment présence sur un même lieu du personnel de l'entreprise utilisatrice et du personnel des entreprises extérieures), d'installations et de matériel (c'est-à-dire présence en un même lieu d'installations et matériels des entreprises extérieures et de l'entreprise utilisatrice).- Opération : L'opération se définit comme « une suite ordonnée d'actes qui suppose une méthode, une combinaison, une recherche de moyens en vue de produire un résultat précis ». Au sens du décret n°92-158 du 20 février 1992, l'opération est constituée soit par une prestation, soit par un ensemble de prestations de services ou des travaux assurés par une ou des entreprises extérieures intervenantes (ou sous-traitantes) en vue de concourir à un même objectif. Il peut s'agir par exemple de la réfection d'un atelier, de l'installation ou la maintenance d'un équipement de travail, d'une intervention sur toiture ou encore sur un réseau électrique.Vous trouverez ICI un schéma de la réglementation applicable en situation de coactivité distinguant l'intervention d'une entreprise extérieure d'une opération de BTP sur un chantier.

Droit de la prévention
1 juin 2022Article R4511-7 du Code du travail
L'objectif de la coordination générale des mesures de prévention par un plan de prévention est de prévenir les risques liés à la co-activité.La co-activité s'entend comme l'interférence entre les activités (ex : rénovation, maintenance), les installations (ex: installations sanitaires, vestiaires, locaux de restauration) et les matériels (ex : chariot élévateur, PEMP) des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail (entreprise utilisatrice, l'ensemble des entreprises extérieures intervenantes y compris les entreprises sous-traitantes).